K.L. Reich - Les Espagnols dans l'enfer de Mauthausen
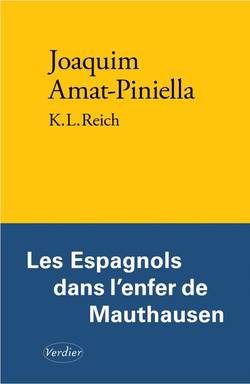
Auteur: Patrice Sabater
Joaquim Amat-Piniella, K.L. Reich. Traduit du catalan par Dominique Blanc, postface de Dominique Blanc, Verdier, 2025, 320 pages, 24 €.
Publié pour la première fois en 1963 dans une version expurgée, puis dans son intégralité en 2001, K.L. Reich,[1] récemment traduit en français, est une œuvre capitale de la littérature concentrationnaire. Rédigé dès 1945 par Joaquim Amat-Piniella, intellectuel Républicain catalan et rescapé du Camp de Mauthausen, déporté de 1941 à 1945 après avoir fui la guerre civile espagnole et l’effondrement de la France. La fonction de ce Camp à la différence de Treblinka, de Dachau ou de Auschwitz n’était pas spécifiquement organisée en vue de la mort (quasi) immédiate, mais autour de la destruction par le travail et l’organisation systématique de la mort dans une sauvagerie sans nom. Sur les 190 000 déportés qui y passèrent, 90 000 y périrent, dont plus de 5 000 Espagnols.
Ce roman est une fiction, et à la fois un témoignage et une méditation politique mémorielle de la vie quotidienne des Républicains espagnols dans l’enfer concentrationnaire. Il retrace avec une précision le parcours de ces Républicains de la fin de la Guerre civile jusqu’en 1939 : l'exil en France, l'internement dans les camps, la participation forcée à l'effort de guerre français, leur arrestation par les Allemands, puis la déportation à Mauthausen. Le roman rend justice à ces oubliés de l’Histoire, apatrides marqués d’un triangle bleu frappé d’un « S » (pour « Spanier »), que la France et l’Espagne franquiste ont abandonnés.
L’auteur ne cherche pas à écrire une simple chronique factuelle. En optant pour la forme romanesque et distanciée. On sent l’humanité de l’homme qui écrit, et l’humanité dans les Camps qui essayent de survivre à l’innommable. Il reste fidèle à l’indicible vérité du Camp de Mauthausen où la morale et l’éthique ne concernent plus ces personnes décharnées, déshumanisées, forcées à travailler et à grimper les escaliers de la mort. « Arbeit macht frei ! » … Les complexités humaines du Camp sont relatées dans des détails souvent saisissants, et qui rendent le récit présent, actuel dans sa singularité. Les personnages sont inspirés de figures réelles — Emili, Francesc, August. Trois personnages pour représenter les différentes formes de survie. Chacun d’eux incarne différentes attitudes face à la déshumanisation : sensibilité, idéalisme et le cynisme : Emili, un artiste qui tente de préserver sa sensibilité ; Francesc, un militant politique fidèle à ses idéaux ; August, un survivant opportuniste prêt à tout. Son personnage est inspiré de César Orquín Serra – un interné espagnol devenu fonctionnaire du Camp, et qui sauva des centaines de coreligionnaires, illustre les ambiguïtés morales de ceux qui ont pu au cœur du système nazi du KZ en détourner les mécanismes à des fins de survie collective. Ces figures représentent différentes manières de résister ou de s’adapter à l’enfer du camp. Joaquim Amat-Piniella montre comment les Nazis retournent l’ordre social en quelque chose d’abject : kapos violents, bordels organisés, hygiène de façade, hiérarchies pourries par la terreur, expériences humaines, sadisme, violences gratuites... L’auteur adopte un style fragmenté, et les tableaux qu’il dépeint recrée l’atmosphère brutale des KZ, où chaque scène est chargée de tension. Les consciences dialoguent entre elles, et font émerger une vérité humaine que bon nombre d’entre eux auraient préférés oublier. Oublier… le peut-on ? Il explore les mécanismes de la déshumanisation, les stratégies de survie, et les fractures politiques au sein des victimes elles-mêmes.
Tout ce qui s’est vécu dans la tragédie espagnole continue à se vivre à Mauthausen comme dans les Camps d’internements sur les plages catalanes du Roussillon, et ailleurs aussi. La division, les dissensions, les idéologies proches et opposées à la fois mâtinent les journées entre solidarité et méfiance, entre fraternité et « compétitions idéologiques ». Les tensions entre Communistes, Anarchistes de la FAI et de la CNT, et les Républicains espagnols dans le Camp prolongent dans l’horreur les désaccords politiques. La Résistance n’est pas idéalisée dans ce récit. On sait trop les heurts et les malheurs, ainsi que le courage et les trahisons de certains. Seules l’amitié et la fraternité soutiennent ces camarades plongés dans les enfers. Faut-il encore le dire ? Il montre la difficulté, désignent les ambiguïtés, et parfois les compromissions. Les fractures idéologiques au sein même des victimes ont entraîné l’Espagne républicaine à la défaite, et pas seulement la supériorité en armes et en soldats de Franco et de ses alliés. L’expérience de Barcelone et ses divisions, comme sur le Front bien présenté par Ken Loach dans son film, en souligne la vérité cruelle.
La bravoure n’est pas davantage mise en avant. Seule la véracité des gestes simples au quotidien tient lieu de mémoire parce qu’il fallait tout simplement survivre : dessiner pour rester humain, protéger un camarade, préserver ce que l’on pouvait encore être quelque chose qui appartenait à « l’être » dramatiquement enfermé comme une bête. La résistance est intérieure, collective et intime à la fois, et si fragile... dans ce microcosme de la condition humaine. Il reste la parole même quand la bouche se tait… Que reste-t-il de l’humanité ? Le dessin pour Emili, la solidarité politique pour Francesc, le souvenir des disparus pour tous. Le roman interroge : Que reste-t-il de l’homme lorsque toute structure morale s’effondre ?
 Le roman dénonce également l’oubli historique : la longue censure franquiste, l’absence de reconnaissance officielle des déportés espagnols. Sa publication tardive et sa redécouverte récente soulignent l’importance de cette mémoire fragmentée que la littérature doit reconstruire. Il ne cherche pas la rédemption ni la consolation, mais la compréhension lucide de l’humain face à l’extrême. Son roman-fiction ne se centre pas sur lui ou sur ce qu’il a vécu directement pour en faire un récit documenté, mais dans une espèce de texte polyphonique et complexe qui présente des personnages fictifs à partir de visages et de vies concrètes à Mauthausen. De la sorte, il permet de dépasser la simple restitution individuelle pour construire une mémoire collective fragmentée. Il s’inscrit à la croisée du roman de guerre, du témoignage concentrationnaire et de la réflexion morale. La réflexion de l’auteur rejoint celle de Primo Levi ou d’André Neher, de Simone Veil, de Jorge Semprun, de Varlam Chalamov, de Geneviève Anthonioz De Gaulle, de Ginette Kolinka ou d’Elie Wiesel pour n’en citer que quelque uns. Elle se concentre également sur la perte d’identité, la fragilité de l’éthique dans un monde inversé, et le rôle ambigu de la Mémoire. Par son style sobre mais précis, sa structure en scènes marquantes et son regard désenchanté mais humaniste, le roman se distingue autant par sa puissance littéraire que par sa valeur documentaire. Yaël Pachet dans sa critique pour « En attendant Nadeau » l’affirme clairement. Ce n’est pas une œuvre rédemptrice, mais une traversée du chaos qui démontre « que c’est bien par le passage d’une voix à une autre que persiste l’être, et que l’amitié est avant tout la forme accomplie de l’anarchie ».
Le roman dénonce également l’oubli historique : la longue censure franquiste, l’absence de reconnaissance officielle des déportés espagnols. Sa publication tardive et sa redécouverte récente soulignent l’importance de cette mémoire fragmentée que la littérature doit reconstruire. Il ne cherche pas la rédemption ni la consolation, mais la compréhension lucide de l’humain face à l’extrême. Son roman-fiction ne se centre pas sur lui ou sur ce qu’il a vécu directement pour en faire un récit documenté, mais dans une espèce de texte polyphonique et complexe qui présente des personnages fictifs à partir de visages et de vies concrètes à Mauthausen. De la sorte, il permet de dépasser la simple restitution individuelle pour construire une mémoire collective fragmentée. Il s’inscrit à la croisée du roman de guerre, du témoignage concentrationnaire et de la réflexion morale. La réflexion de l’auteur rejoint celle de Primo Levi ou d’André Neher, de Simone Veil, de Jorge Semprun, de Varlam Chalamov, de Geneviève Anthonioz De Gaulle, de Ginette Kolinka ou d’Elie Wiesel pour n’en citer que quelque uns. Elle se concentre également sur la perte d’identité, la fragilité de l’éthique dans un monde inversé, et le rôle ambigu de la Mémoire. Par son style sobre mais précis, sa structure en scènes marquantes et son regard désenchanté mais humaniste, le roman se distingue autant par sa puissance littéraire que par sa valeur documentaire. Yaël Pachet dans sa critique pour « En attendant Nadeau » l’affirme clairement. Ce n’est pas une œuvre rédemptrice, mais une traversée du chaos qui démontre « que c’est bien par le passage d’une voix à une autre que persiste l’être, et que l’amitié est avant tout la forme accomplie de l’anarchie ».
(Photo - © Arxiu Comarcal del Bages. Fons Joaquim Amat-Piniella)
La Mémoire de la déportation des Républicains espagnols, a été jusqu’à aujourd’hui largement marginalisée dans les récits officiels de la Seconde Guerre mondiale. Longtemps oubliée en raison de la censure franquiste, de la marginalisation des voix républicaines en exil, et de la marginalisation linguistique du Catalan, ce livre finit bienheureusement à émerger aujourd’hui comme un texte essentiel pour comprendre à la fois les Camps nazis, et la ténacité de ces hommes et de ses femmes face à l’horreur implacable de l’idéologie nationale-socialiste du régime nazi. La Mémoire des Républicains espagnols déportés, rejetés par Franco et abandonnés par l’Europe. Durant des décennies, on s’est centré, sans doute avec raison, sur la déportation des Juifs, et l’on a oublié d’autres déportés tels que les Républicains espagnols, les Tziganes, les Homosexuels, les « asociaux » comme les personnes déficientes mentalement ou handicapées…
Plus qu’un roman historique, K.L. Reich est une page mémorielle de courage, de lucidité qui sait remettre les choses là où il convient de les mettre. Il rectifie des axes et des imaginaires, et met en exergue des faits utiles et probants. Un livre essentiel oublié, qui trouve enfin un public qui souhaite comprendre et être informé à ce moment charnière de l’Histoire. Enfin, pour ne pas oublier, en 1943 un jeune photographe espagnol - Francisco Boix - sauve de la destruction les photographies prises par les SS de Mauthausen ; ce qui nous renseigne énormément sur l’espace concentrationnaire nazi. L’an prochain nous célèbrerons une date importante : 1936-2026 ou les 90 ans de l’entrée en guerre des deux Espagnes : l’une démocratique et républicaine, et l’autre fasciste et dictatoriale. Avec gratitude, nous pouvons remercier les Éditions Verdier de nous donner ce livre, qui rejoint enfin le panthéon des récits de la déportation... espagnole et républicaine. À lire !
[1] KL – KZ - « Konzentrationslager »

