Deviens ce que tu es
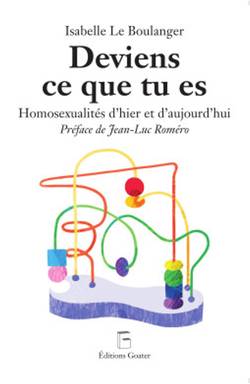
Isabelle Le Boulanger, Deviens ce que tu es : homosexualités d’hier et d’aujourd’hui. Éditions Goater, Rennes, août 2024. 380 pages (19,80 €)
Homosexualités d’hier et d’aujourd’hui
Parler de l’homosexualité ne relève pas aujourd’hui des mêmes schémas de pensée qu’il y a cinquante ans, et plus encore. Certains milieux parisiens prétendent à juste titre qu’être homosexuel-elle aujourd’hui est une chose définitivement acquise et entrée dans « l’ordre des choses ». Effectivement, on pourrait le penser dans le microcosme parisien, mais il n’en n’est rien parce qu’il y autant de situation et de façons de vivre son affectivité et sa préférence envers un autre garçon ou une autre fille qu’il y a de gay ou de lesbienne. Être homosexuel à Paris n’a rien du tout à voir avec le fait de vivre pleinement ce que l’on est en Province, dans le rural ou encore en dehors de la Métropole.
Dans son livre récent « Deviens ce que tu es », l’historienne et chercheuse associée au Centre de recherche bretonne et celtique (Université de Bretagne occidentale), Isabelle Le Boulanger interroge trois générations de femmes et d’hommes (18 femmes et 16 hommes de 30 à 74 ans), qui témoignent de l’évolution de l’intégration des homosexuels dans la société française durant ces quarante dernières années. Son travail porte sur la représentation de l’homosexualité et son intégration en France. Le retour sur la période souligne le chemin parcouru, et la lutte pour conquérir des droits et une visibilité plus « normée » ou « normalisée ». Un jeune aujourd’hui découvrant son affectivité aura sans doute plus de facilité à pouvoir parler et à trouver des lieux de « refuge » que lorsque le fait d’être gay était non seulement un délit mais un crime. Il aura fallu presque trois siècles pour que des avancées socio-culturelles permettent des avancées ; et bien que les lieux confessionnels aient été les plus réticents jusqu’à aujourd’hui pour préparer les mentalités positivement.
Pareillement, l’endurance et l’opiniâtreté pour faire reconnaître le droit en Europe à exister aux célébrations mémorielles autour des crimes perpétrés par les nazis ont porté des fruits. Comme le souligne dans sa thèse Régis Schlagdenhauffen, montre bien que le chemin ne fut pas aussi simple : « Depuis les années 1970, les commémorations des victimes homosexuelles du nazisme se multiplient à travers l’Europe. À travers elles, des militants de la mémoire réclament la reconnaissance et l’inclusion des homosexuels au sein du martyrologe des victimes du nazisme. Ces demandes sont cependant controversées. Les opposants considèrent que les homosexuels sont des criminels (puisque leurs pratiques étaient condamnées par la loi) et ne peuvent donc pas être des victimes. Le sentiment d’injustice considérée comme un déni de reconnaissance par des militant-e-s homosexuel-le-s est à l’origine de mobilisations mémorielles. L’examen des mobilisations a permis d’interroger la commémoration en tant que stratégie de reconnaissance. La commémoration des victimes homosexuelles du nazisme apparaît éminemment spécifique car elle articule trois niveaux de reconnaissance. Au niveau culturel, elle vise la reconnaissance du groupe dans la durée. Au niveau légal, elle vise l’obtention du statut individuel de victime du nazisme tout comme celui du statut collectif de groupe de victimes. Au niveau social, elle vise l’inscription topographique du groupe dans l’espace. De plus, la reconnaissance possède un impact économique. Se pose alors le problème de la redistribution c’est-à-dire l’obtention de réparations financières ».
Il faudra attendre 2021 pour que le Mémorial de la Shoah, à Paris, propose une exposition sur cette thématique, et afin que Pierre Seel et ses coreligionnaires soient mis sous les feux de l’actualité historique sociale. Elle présentait des parcours de vie qui témoignaient du destin hétérogène des hommes et des femmes homosexuels durant cette période. Le chemin se fit en France au moment des célébrations, mais également aussi avec la dépénalisation de l’homosexualité inscrite dans le Programme de gouvernement de François Mitterrand, alors candidat socialiste à la Présidentielle, en promulguant la loi du 4 août 1982. Les Années de l’insouciance autour de la vague du Disco et de la Movida espagnole ont laissé place à la désespérance et à l’horreur du début de la pandémie du VIH. La peur venait fracasser la communauté homosexuelle en plein cœur, et la mettait d’une façon toute particulière sous les feux de la critique, de l’ostracisme, de l’homophobie et du rejet. A cette loi ouvrant des horizons nouveaux viendront s’ajouter d’autres dispositifs légaux ; dont la loi concernant le PACS et le « Mariage pour tous » (17 mai 2013) conquise de hautes luttes par Christiane Taubira et la majorité d’alors.
On l’aura compris la reconnaissance et l’intégration n’ont jamais été facile pour cette communauté et pour les individualités qui la compose. Aussi, il n’y a pas une seule façon d’être homosexuel ; et c’est sans doute pour cette raison que l’autrice est plutôt encline à en parler au pluriel. Bien évidemment, selon où l’on se situe (à Paris ou en Province), selon la catégorie socio-professionnelle ou son emploi, son sexe ou son âge chacun vivra son affectivité d’une façon ou d’une autre. Il n’est donc pas facile d’être ce que l’on est, et de le devenir ; c’est-à-dire de laisser émerger cette partie de soi-même ontologique et consubstantielle de façon désinvolte, libérée, apaisée en se disant qu’aujourd’hui l’homosexualité est définitivement intégrée dans le paysage. Néanmoins, il est indéniable qu’il y a des avancées notoires et spectaculaires entre ce qui était vécu alors et ce qui se vit maintenant (nombre d’établissements LGBTQ+, de réseaux, d’organismes de santé, d’associations, de médecins et d’avoués gayfriendly, de lieux d’écoute, la tenue d’une Marche des fiertés dans chaque grande ville de France et d’Europe…). Jean-Luc Romero, dans sa Préface, le souligne avec joie et intérêt ; et il a parfaitement raison même s’il faut reconnaître une recrudescence inédite d’actes homophobes en France, en Europe, et dans beaucoup de pays.
Les chiffres montrent que le taux de suicide est quatre à sept fois plus élevé chez les garçons homosexuels de moins de 25 ans, comparé aux hétérosexuels. « L’homosexualité féminine est moins visible. Deux femmes vivant ensemble, on pourra penser que ce sont des copines colocataires, sans imaginer qu’elles vivent une relation amoureuse. Deux hommes sous un même toit, on ne se dira pas que ce sont des potes. Les lesbiennes, moins exposées aux agressions, seraient, cependant, davantage touchées par des épisodes dépressifs graves que les hétérosexuelles » (Isabelle Le Boulanger, in. Ouest France – Février 2025).
Dans cet ouvrage, deux grandes Parties et plusieurs chapitres rendent compte à la fois du chemin parcouru depuis plus d’un demi-siècle, mais aussi du chemin « pour devenir soi » : de la découverte de l’homosexualité à l’acceptation de ce que la personne homosexuelle est, et devient « en s’assumant » soi-même ou du Outing ; et ce qui conduit bien souvent à être confronté à diverses difficultés personnelles, familiales, professionnelles ou sociétales. S’avouer à soi-même ce que l’on est reste un poids et un challenge ; et cela est d’autant plus vrai quand le jeune adolescent est rejeté par ses parents, sa fratrie, sa famille, ou son entourage immédiat. Le milieu scolaire, universitaire et professionnel restent des lieux où se dire devient souvent un marqueur de mise à l’écart, d’ostracisme, d’homophobie (propos et actes punis par le législateur depuis 2024). Ce sont autant de lieux qui conduisent parfois à des dépressions, à un mal-vivre, à des délits, et même à des meurtres.
Isabelle Le Boulanger dans ce document très bien documenté ajoute aux faits sociologiques et aux mentalités un supplément d’âme. L’autrice propose un chemin, une rencontre et des découvertes à travers les entretiens menés dans la délicatesse des propos échangés. Elle est à la fois celle qui mesure le temps et les mentalités, mais qui met tout à la fois un cœur à vivre la proximité avec cette communauté pour qu’elle passe du « Refuge » aux larges horizons dégagés et épanouis qui sont communs à tous les Hommes. À lire, bien évidemment !!!
« Il n’est que temps d’ailleurs de prendre conscience de tout ce que la France doit aux homosexuels comme à tous ses autres citoyens, dans tant de domaines » —
Robert Badinter, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, à l’Assemblée nationale, le 20 décembre 1981.

